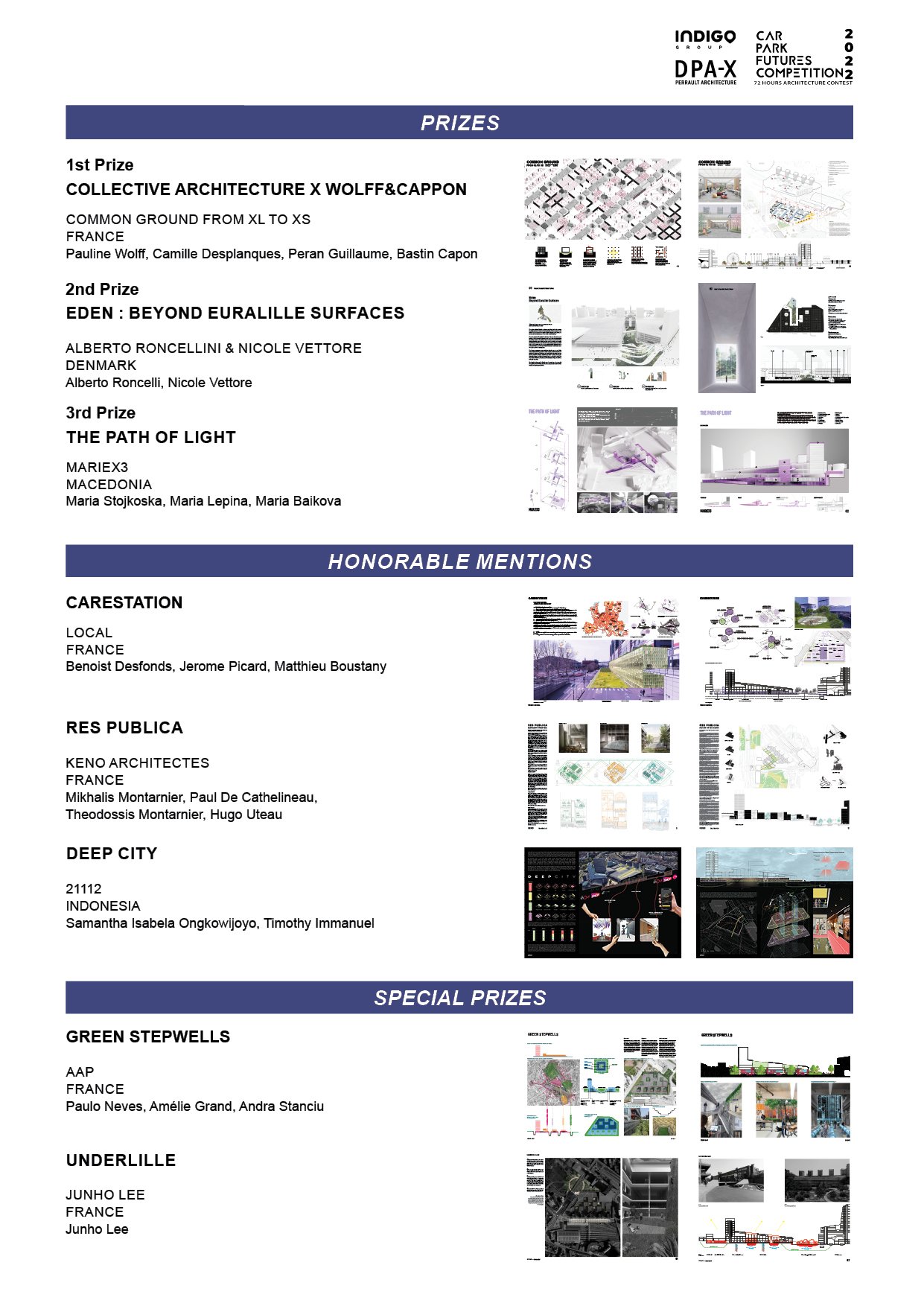DPA–X
CONSULTING SERVICES
ARCHITECTURe INTELLIGENCE
Design Strategy
RESEARCH & DEVELOPMENT
info@dpa-x.com
@dpa__x
4 rue Bouvier, 75011 Paris
France
DPA–X is a sister company of Dominique Perrault Architecture (DPA).
DPA–X offers consulting services in architecture, urbanism & design.
DPA–X makes DPA’s architectural expertise accessible beyond buildings.
DPA–X works with curated international talents for each project.
DPA–X services can be public or private.
DPA–X welcomes unsolicited demands.
EVENTS
Discover the awarded projects !
–
CARPARK FUTURES COMPETITION
2022 • For Indigo Group
DPA- X + INDIGO
PROJECTS
–
CARPARK FUTURES : OPPORTUNITIES IN THE UNDERGROUND
2020 • For Indigo Group
Study of underground carpark architecture for Indigo Group, the world leader in car parks. Integration, diversification and integration within contemporary dynamics. Production of digital report and a video on the future of underground parking featuring four urban scenarios : the Parking Retrofit, the Deep Square, the Deep Avenue & the Deep Ground.
Content : Video & Report (EN-中文-FR)
–
DISTRICT 2024 : FROM FICTIONS TO URBAN PROJECTS
2020 • For Dominique Perrault Architecture
District2024 gathers a regularly updated collection of fictional projects and potential developments that relate to an illustrative neighborhood, set in an active city, Saint-Denis, France, on the North edge of Paris. This “idea board” is addressed to architects, city-makers and public developers looking to foster innovative approaches in particular urban fabrics.
Content : Blog (FR)
–
2016 • For French Government
For over 2000 years, the Île de la Cité has been the heart of Paris. Faced with many transformations with the departure of several State institutions (heightened now with the fire of Notre Dame), the French President François Hollande commissioned Dominique Perrault, architect & planner, and Philippe Bélaval, heritage historian, to identify the challenges and opportunities of the island, particularly in terms of culture and tourism. The study proposes a cohesive urban approach to open the island to Parisians and to the world by reconciling economic activity and heritage conservation.
Content : Exhibition & Report (FR)
–
HÔTEL MÉTROPOLE : A DEVICE FOR LIFE IN THE GREATER PARIS
2014 • For Atelier International du Grand Paris
The study is the answer by the multi-disciplinary team of DPA to the question of “Life in the greater Paris” posed by the International Workshop on Greater Paris (AIGP) in 2013. Following a research period, the team proposed a new type of urban devices called ‘Metropolitan Hotels’ to create a series of poles of intensity strategically spread across the territory to foster its development. The was team comprised of Dominique Perrault (architect&planner), Frederic Migayrou (philosopher), Brigitte Loye Deroubaix (architect&planner), Jean-Louis Subileau (planner), Henri Berestycki (mathematician), Richard Copans (film-maker).
Content : Report (FR)
–
GROUNDSCAPE : DESIGNING THE UNDERGROUND
2013 • For Dominique Perrault Architecture
Initiated by Dominique Perrault, the concept of groundscape, mixing underground and landscape, addresses the architectural gestures and the spatial strategies for the development of the underground. Under-explored, under-considered, and under-valued by architects and by planners, the potential of the underground is multiple and it opens to new frontiers for the development of cities and infrastructures.
Content : Exhibition & Website (EN/FR)
–